Analyse Ethique
Qu'est ce que l'éthique ?
L’éthique est souvent assimilée à la morale,
bien qu'elles soient deux choses différentes.
Les deux visent à définir si une action est bien ou mal,
mais la morale est propre à une personne,
tandis que l’éthique a pour but d’être discutée.
L’éthique a donc plus pour but d’orienter notre choix lorsque l’on est face à un dilemme.
Par exemple, si nous nous fixons des principes à suivre,
comme être juste et ne pas faire le mal, il est souvent impossible de les suivre tous.
Dans notre exemple, être juste revient parfois à faire du mal à quelqu’un
(les juges d’un tribunal sont un bon exemple).
L’éthique a alors comme objectif de discuter sur le sujet afin de décider du choix à faire.
Il existe beaucoup de courants d’éthique.
Nous en avons sélectionné plusieurs que nous allons d’abord expliquer,
et avec lesquels nous allons développer les points soulevés dans la partie introductive.
L’éthique des vertus, ou éthique d’Aristote, est,
comme son nom l’indique, basée sur la vertu.
Aristote considérait que, pour être une bonne personne,
il faut répéter des actions qui ne sont ni trop, ni trop peu vertueuses.
Plusieurs vertus sont mises en avant, comme l’honnêteté,
la sympathie, le courage, la prudence ou la sagacité.
Si on prend l’exemple du courage, le trop peu représenterait la lâcheté et
le trop représenterait la témérité.
La principale différence entre l’éthique des vertus et l’éthique des conséquences
est qu’en vertu, l’intention est primordiale.
Une même action peut être considérée comme éthiquement correcte
ou non d’un point de vue des vertus si on ne change que son intention.
Il est alors primordial de penser que nos actions sont bonnes et vertueuses,
sans se soucier réellement des conséquences.
Cela ne s’oppose cependant pas au conséquentialisme:
la vertu a souvent pour but d’atteindre de bonnes conséquences.
Par exemple, si l’on joue à un tournoi d’un jeu quelconque
dans le but de s’amuser, alors tricher n’est pas considéré comme correct.
En revanche, si l’on joue afin d’obtenir la récompense du tournoi pour une bonne raison,
alors la triche peut être considérée comme une action correcte
(à condition de ne pas se faire prendre évidemment).
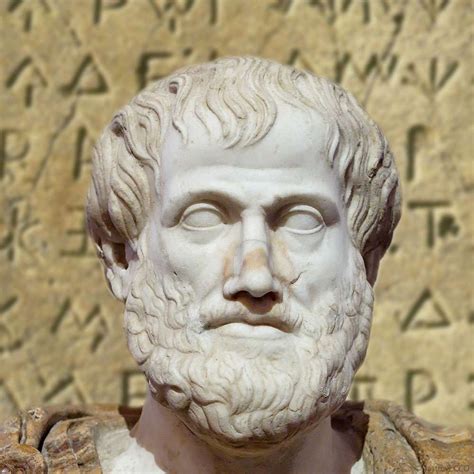
Aristote
L’éthique déontologique de Kant dit qu’une action
doit être jugée en fonction de certains devoirs.
On doit donc respecter certains principes à partir du moment
où ceux-ci peuvent être jugés universels.
Cette forme d’éthique s’oppose au conséquentialisme,
qui jugera une action sur les conséquences et non sur les principes de l’acteur.
De nombreux milieux professionnels sont soumis
à ce que l’on appelle une déontologie professionnelle.
On y retrouve, par exemple, la déontologie des médecins ou le secret professionnel.
Selon l’éthique des devoirs, il ne faut pas mentir.
Dès lors, si un soldat allemand de la seconde guerre mondiale
frappait à votre porte pour vous demander si vous cachiez des juifs,
vous seriez contraint de lui dire la vérité.
Et ce, même si cela met en danger la vie de quelqu’un.
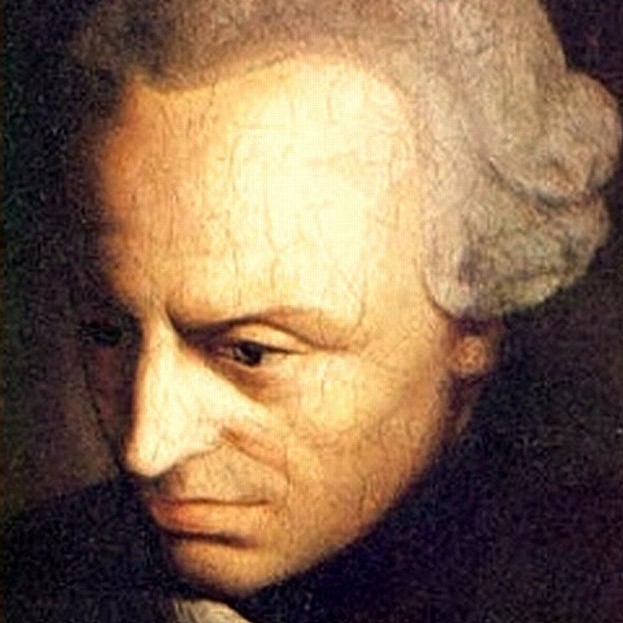
Emmanuel Kant
L’éthique conséquentialiste est surement la forme d’éthique la plus simple à comprendre.
Si nous avons une décision à prendre, nous listons tous les choix possibles et l’on choisit
celui qui a le plus de conséquences positives et le moins de conséquences négatives.
Les conséquences positives seront appelées les plaisirs
et les conséquences négatives seront appelées les peines.
On va donc maximiser les plaisirs et minimiser les peines.
C’est une manière très cartésienne de voir l’éthique,
au point où l’on peut établir une formule mathématique empirique
qui définit les choix que l’on doit prendre lorsque l’on est face à un certain dilemme.
On peut également définir des plaisirs et des peines dits "supérieurs"
et essayer d’éviter à tout prix les peines supérieures
et d’acquérir à tout prix les plaisirs supérieurs.
De nombreux exemples permettent d’illustrer l’éthique conséquentialiste.
On peut reprendre celui de l’allemand qui vient frapper à votre porte.
Cette fois-ci, vous devriez mentir car ce choix sauverait des vies!
L’éthique conséquentialiste est (comme toute les éthiques) très discutée.
C’est ce qu’a effectué Nozick avec sa machine à expérience décrite
ci-dessous.
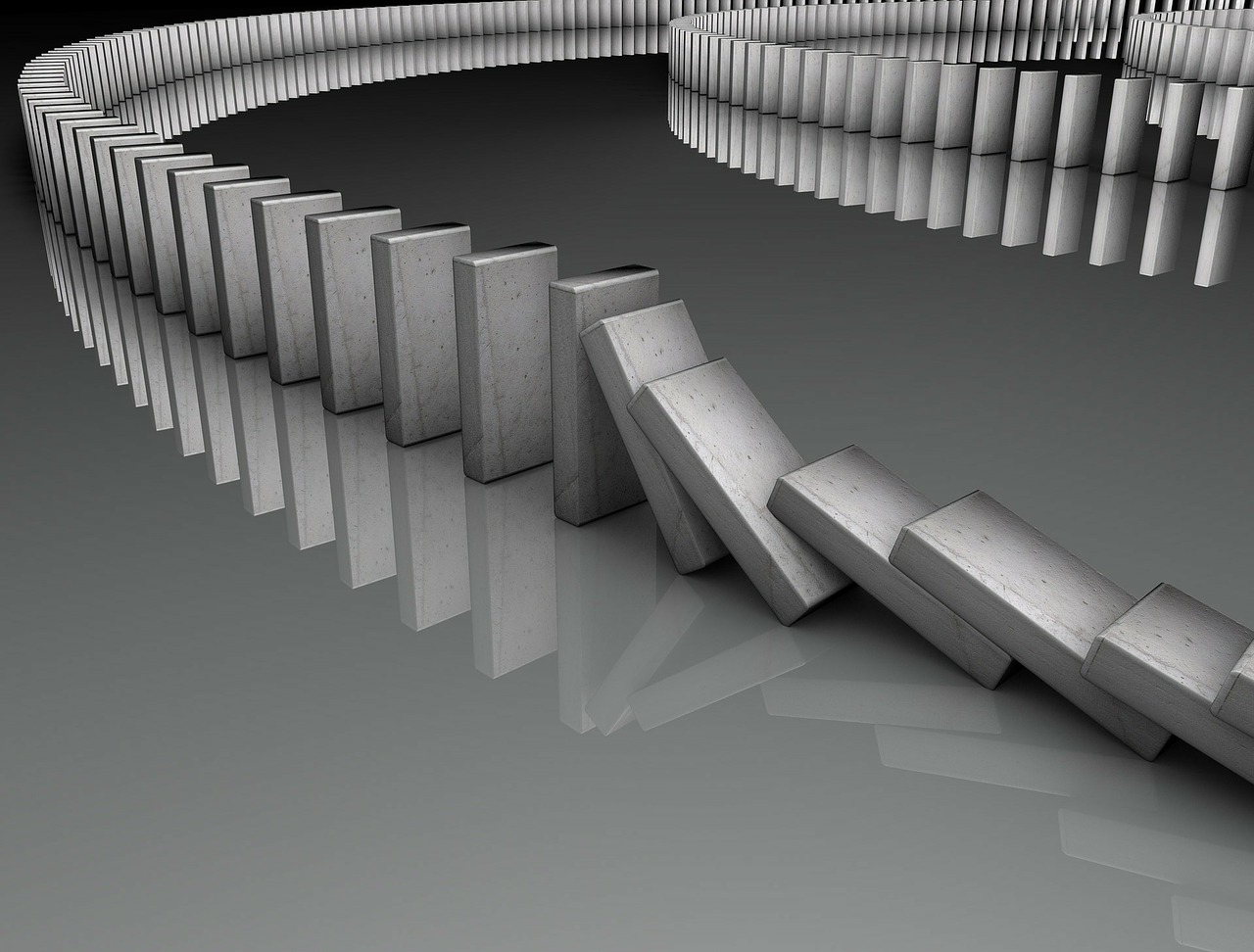
Nous pouvons nous rendre compte que nous suivons en général plusieurs éthiques
durant notre vie, et non une seule.
Cela parait logique puisque que les éthiques ne se contredisent pas toujours
et sont parfois d’accord entre elle. Mais même comme ça, on ne se limite pas à une seule éthique.
La majorité des êtres humains se fixent une morale
qu’ils essaient de respecter au maximum.
Ils peuvent aussi être soumis à une déontologie professionnelle.
Lorsque notre morale ou nos devoirs ne nous aident pas à faire un choix,
on pèsera le pour et le contre des possibilités,
comme le dicte l’éthique conséquentialiste.
Nous appliquons l’éthique des vertus le plus souvent à l’instinct,
quand nous n’avons pas le temps de réfléchir et de considérer toutes les options possibles.
La Machine de Nozick
Robert Nozick, un philosophe du XXe siècle, propose dans son livre
"Anarchy, State and Utopia" l'expérience suivante :
"Supposez qu’il existe une machine à expérience qui soit en mesure de vous faire vivre
n’importe quelle expérience que vous souhaitez. [...]
Faudrait-il que vous branchiez cette machine à vie,
établissant d’avance un programme des expériences de votre existence ? [...]
Evidemment, [tant que vous êtes connectés à la machine,] vous penserez que ça se passe vraiment."
Vous pouvez donc vivre la vie que vous voulez.
Tout ce que vous pouvez imaginer peut-être vécu dans la machine.
La machine de Nozick va donc poser un dilemme entre le bonheur et la vérité.
Nozick propose plusieurs argument pour ne pas se connecter à la machine:
- "Nous voulons faire certaines choses, et pas seulement avoir l'expérience de les avoir faites"
- "Nous voulons être une certaine personne - Se connecter est une forme de suicide"
- "Nous sommes limité par la réalité humaine"
Nous ne pouvons évidemment pas conclure que ne pas se connecter à la machine
est la meilleure solution sur le simple argumentaire de Nozick.
Certaines personnes pourraient préférer se connecter à la machine.
C'est notamment le cas si on aborde le problème d'un point de vue conséquentialiste,
étant donné que l'on aura plus de plaisir à se connecter à la machine qu'à ne pas le faire.
Nozick dit que les personnes qui se connecteraient à la machine sont des personnes
pour qui seul le plaisir compte.
On peut cependant avoir un avis plus mitigé en se disant que,
si notre vie réelle est malheureuse, le mieux pour nous serait de se connecter à la machine
afin d'éprouver un peu de bonheur.
De plus, si une personne souhaite se suicider,
il est préférable qu'elle se connecte à la machine plutôt qu'elle mette fin à ses jours.
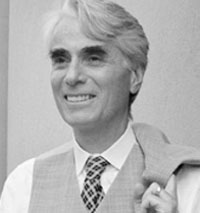
Robert Nozick
Nous pouvons également imaginer une situation où plusieurs personnes sont interconnectées
à la même machine, voire le monde entier.
Dès lors, la machine ne permettrait plus de procurer uniquement le bonheur,
car parfois le bonheur des uns équivaut au malheur des autres.
Cependant, la machine pourrait améliorer la situation de vie de tout le monde,
et doser de manière équivalente le bonheur de chacun.
Si l'on se connecte à la machine, cela signifie que l’on accepte que
la machine devienne notre réalité.
Dès lors, s'il s'agit de notre réalité, il s'agit également de notre vérité,
car nous n'aurions aucune manière de connaitre les vérités externes à la machine.
Si une personne était connectée à la machine depuis sa naissance,
et que nous viendrions à lui proposer un jour de se déconnecter pour vivre une vie "réelle",
cette personne devrait refuser car elle n'a aucune preuve qu’il s’agisse bien de la réalité.
Pour elle, la réalité est le monde dans lequel elle a toujours vécu.
Nous pouvons également nuancer l'expérience de la Machine de Nozick
en spécifiant que rien ne nous oblige à rester connecté à la machine.
Nous pourrions très bien nous connecter momentanément pour quelques heures,
puis revenir dans le monde réel.
Cela permettrait de rendre possible des expériences inaccessibles ou dangereuses
à tous ceux qui le souhaiteraient.
Les éthiques appliquées à l'immersion totale:
Les principaux aspects qui vont nous intéresser ont déjà été cités dans la partie introductive, à savoir le cas de l’addiction, la notion de réalité et les aspects thérapeutiques et médical.
Cette personne pourrait d'abord être considérée comme fainéante, ce qui serait contraire à l’éthique des vertus. Il faut cependant prendre en compte que, si cette personne peut effectivement être considérée comme oisive dans ce monde, il n’en est peut-être rien dans le monde virtuel. Elle y serait peut-être travailleuse, à devoir sans cesse se donner pour vivre et améliorer ce qu’il considère comme étant une réalité plus intéressante que celle qu’il a délaissée.
Il faut cependant prendre en compte que vivre dans un monde virtuel représente une certaine lâcheté. Cela reviendrait à fuir la réalité plutôt que de l’affronter. On choisirait donc la simplicité. Comme l’a dit Nozick, vivre entièrement dans un monde virtuel serait une forme de suicide dans notre monde.
En revanche, si c’est la norme de vivre partiellement ou entièrement dans des mondes virtuels interconnectés, et qu'il est possible de vivre avec d’autres personnes dans ces mondes d’immersion totale, il ne s’agirait plus de suicide. On peut alors difficilement parler de lâcheté si l’on vit dans un monde virtuel, car l’on n’y vit pas forcément pour fuir la réalité.
L’éthique des vertus est donc très mitigée sur le principe de vivre dans un monde virtuel. En fonction des circonstances, elle l’accepte ou non. Nous pouvons même nous dire que faire vivre l’entièreté de l’humanité dans un monde virtuel serait la solution pour cette forme d’éthique, car un monde virtuel représenterait la plus grande forme de sécurité, de justice car tous les humains y seraient égaux et plus facilement protégé des meurtres et des maladies.
Du point de vue des aspects thérapeutiques de l’immersion totale, bien qu’il s’agisse d’un manque de courage du patient qui souhaite se faire soigner de son trouble psychologique, il s’agit bien d’une preuve d’humanité de vouloir soigner les autres afin que ceux-ci puissent vivre comme tout le monde. On peut même y voir une forme de justice en supprimant les défauts psychologiques des humains pour rendre tout le monde égal.
Pour finir, l’utilisation de l’immersion totale dans le cadre de l’entrainement à un métier, comme une opération pour des chirurgiens, ou même dans l’entrainement d’un sport ou de quoi que ce soit d’autre, semble être totalement en accord avec le fondement même de l’éthique des vertus. Pour rappel, l’éthique des vertus considère que c’est par l’habitude et la répétition de tache vertueuse que l’on devient quelqu’un de bien. Dès lors, l’entrainement à un métier, si celui-ci est considéré comme vertueux, est quelque chose de totalement accepté et encouragé par l’éthique des vertus.

Comme précisé ci-dessus, l’éthique déontologique précise déjà qu’il ne faut pas mentir.
Il parait alors évident que la vie dans un monde d’immersion totale revient
d’une certaine manière à se mentir à soit même, étant donné que l’on n’accepte pas la réalité,
qui est par définition la vérité.
Selon l’éthique de Kant, l’échange de réalité serait alors totalement prohibé.
On ne pourrait pas non plus vivre les plaisirs à l’aide de l’immersion totale,
à la manière de la machine de Nozick.
Si l’on prend en revanche une utilisation modérée de l’immersion totale
dans le cadre du divertissement, comme jouer à un jeu en réalité virtuelle de temps en temps,
l’éthique des devoirs ne s’y opposerait pas.
Il est cependant important pour cette éthique que le divertissement n’empêche pas
l’accomplissement de ses devoirs, quels qu’ils soient.
Le divertissement doit alors venir en second plan, durant son temps libre,
et ne doit en aucun cas aboutir à de l’addiction.
Prenons maintenant un dernier cas d’utilisation de l’immersion totale: apprendre ou s’entrainer à une tâche, principalement un métier, à l’aide de monde virtuelle. Nous pouvons prendre l’exemple du chirurgien qui s’entrainerait à effectuer une opération sur un modèle généré dans un monde virtuel.
Cette utilisation de l’immersion totale n’est pas seulement tolérée par l’éthique de Kant, mais est presque une obligation. Dans le cas du chirurgien, il est de son devoir de savoir effectuer correctement son opération, et il est donc de son devoir de s’entrainer à opérer de la manière la plus parfaite possible. Un chirurgien doit donc tout faire pour perfectionner son talent et peut donc utiliser toutes les technologies à sa disposition. Ce raisonnement peut s’étendre à presque n’importe quel métier.
On peut cependant imaginer des situations où les conséquences d’une connexion peuvent apporter moins de plaisir que de peine. Supposons une personne très banale, qui vit avec ses parents ou qui a elle-même des enfants, qui a des amis, de la famille, etc. Se connecter à un monde virtuel reviendrait alors à abandonner tous les proches que l’on a dans la réalité, ce qui est une plutôt grosse peine, surtout si l’on tient à eux et qu’ils tiennent à nous.
On pourrait imaginer que cette personne se connecterait avec tous ses proches afin de ne pas les abandonner, mais il faudrait alors aussi connecter les proches de ses proches, et ainsi de suite. Par effet boule de neige, tout le monde se retrouverait connecté au monde virtuel. Il faut aussi prendre en compte que les proches doivent être d’accord de se connecter. Ils pourraient préférer leur vie dans le monde réel que dans un monde virtuel.
On voit alors que la connexion éternelle à un monde virtuel est tout de même assez mitigée, même pour l’éthique des conséquences. On peut cependant imaginer une connexion temporaire au monde d’immersion totale afin de ne pas avoir à abandonner ses proches.
L’éthique conséquentialiste pourrait même aller jusqu’à permettre à l’immersion totale de nous donner une seconde vie. Dans le cas où le corps deviendrait inutilisable dans la réalité (autrement dit, dans le cas où l’on viendrait à mourir), nous pourrions simplement sauvegarder notre conscience et perdurer dans un monde virtuel. Il faut cependant prendre en compte que nous devons éviter les conséquences néfastes, et que l’on ne peut pas toutes les anticiper car les technologies qui permettraient de le faire n’existent pas encore.
Prenons pour finir le cas de l’utilisation de l’immersion totale en médecine. Par exemple, le fait de soigner une phobie en effectuant une thérapie faisant intervenir les technologies d’immersion totale. En supposant qu’il n’y ait pas d’effet secondaire à la thérapie, on ne voit à première vue que des conséquences positives. Il en est de même pour l’apprentissage de métier, comme l’exemple du chirurgien qui opère dans un monde virtuel pour s’entrainer.
Nous remarquons déjà que les éthiques ne s’accordent pas sur beaucoup de point. Il y'a tout de même une certaine tendance à être contre l’échange de réalité et pour l’utilisation dans la médecine ou dans d’autres métiers.
Nous pourrions faire des analyses selon d’autres courants d’éthiques, ce qui ne pourrait qu’être utile évidemment. Mais nous arrivons déjà à voir une tendance dans leur manière de penser sur l’immersion totale. De plus, les courants analysés ici sont souvent considérés comme les principaux mouvements d’éthiques.
Nous nous concentrerons maintenant plus sur l’avis d’autres personnes, d’abord à l’aide d’un sondage, ensuite en interviewant de manière plus précise des personnes qui seraient intéressées par le sujet.

